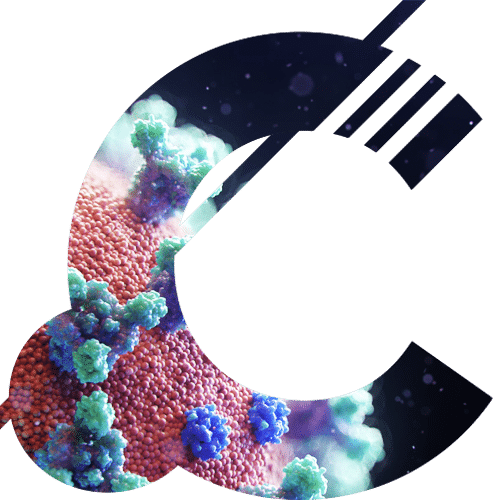Depuis le début du confinement nous n’entendons plus parler que du monde d’après, qui sera différent, forcément différent. C’est un point qui fait pour une fois l’unanimité et traverse tout l’échiquier politique. Il en dit long sur l’attachement que nous avions au monde d’avant, celui d’il y a à peine quelques semaines… Ainsi donc, toute personnalité politique sait que le monde d’hier est invendable. Quel échec collectif quand on y pense !
On ne veut plus
Il faut dire que les dysfonctionnements liés à la crise du coronavirus ont mis en évidence les rouages peu reluisants de notre système. Délabrement de notre système de santé, inégalités criantes entre classes sociales, incapacité à produire des masques en France ou à récolter des asperges sans main d’oeuvre bon marché venue de l’Est de Europe. La lumière s’est allumée, nous donnant à voir le monde tel qu’il fonctionne.
Quiconque dirait que tout allait bien avant l’arrivée du virus serait cependant malhonnête. L’état de l’hôpital public n’est pas une surprise après des années de dénonciations, de luttes et de grèves des soignants. Par ailleurs, après les Gilets Jaunes, nous ne pouvions ignorer les conditions de vie dégradées d’une grande partie de la population. Plus généralement, le manque de sens au travail et le burn out étaient déjà des fléaux bien répandus. Et surtout, la conscience de l’impasse écologique dans laquelle notre mode de développement nous emmène était de plus en plus prégnante.
Bref, on ne peut donc pas dire que cette crise nous a trouvés en plein épanouissement collectif, sûrs de la pérennité de notre mode de vie… Il n’est pas surprenant que le changement soit attendu, et souhaité.
Ce que nous voulons
Malgré tout, nous sentons que le monde d’après a de grandes chances de ressembler furieusement à celui d’avant, le business as usual nous reprenant dans sa course effrénée vers l’abîme. C’est évidemment le scénario le plus probable. Est-ce parce que ce que nous voulons n’est pas clair ou parce que nous aurions été incapables de nous accorder sur la direction à prendre ? A bien y regarder il semble pourtant qu’on pourrait mettre d’accord beaucoup de monde autour de principes communs.
La pause actuelle de la consommation nous offre la possibilité de réfléchir à ce dont nous avons vraiment besoin. Produire moins, répartir mieux, travailler moins, ralentir, pourraient séduire largement. Moins de biens, plus de liens, comme le répète à l’envi François Ruffin depuis quelques temps.
Beaucoup seront aussi d’accord pour faire progresser la démocratie. Qu’elle ne se limite pas à voter une fois tous les 5 ans pour un monarque tout puissant mais que des centres de décisions alternatifs soient mis en place et que de réels contre-pouvoirs puissent s’exercer. Que l’économie entre dans le champ démocratique pour que nous puissions décider collectivement des secteurs dans lesquels investir et retrouver du sens au travail. Le souhait que nos services publics, qui sont nos biens communs, soient restaurés et protégés est aussi largement partagé. Une fiscalité plus juste, une véritable lutte contre les paradis fiscaux et les inégalités telles que le réclame un groupement d’ONG, syndicats et associations dans l’appel “Plus jamais ça” sont aussi des mesures qui pourraient rassembler largement.
Mais c’est sans doute quand on s’intéresse aux mesures nécessaires à la préservation de notre écosystème que le consensus sera le plus facile à trouver. Relocaliser la production, vivre plus sobrement, produire moins et mieux, mettre fin à l’obsolescence programmée, réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre en réduisant notre consommation énergétique, aller vers une agriculture respectueuse de l’environnement sont quelques mesures non seulement souhaitables mais absolument nécessaires à la survie de l’espèce humaine, et des autres espèces.
Alors quoi ? Beaucoup d’idées semblent pouvoir faire consensus, non ? Quelles sont les forces de résistance ?
Nos dirigeants
Comme à chaque crise, nos dirigeants nous disent avec des trémolos dans la voix qu’ils ont compris la leçon, qu’ils ont changé, que plus rien ne sera comme avant. Notre président M. Macron pousse même l’affront jusqu’à terminer son discours du 13 mars en nous annonçant le retour des jours heureux, allusion évidente au programme du Conseil National de la Résistance. Après avoir passé 3 ans à déconstruire tous les acquis de ce dernier, des retraites à notre système de santé, il fallait oser. Mais nous ne sommes plus tellement surpris en réalité, nous commençons à avoir une bonne habitude de la maltraitance orwellienne du langage par la macronie. La suppression de l’ISF ne fut-elle pas présentée comme une mesure de justice sociale tandis que les restrictions au droit de manifester étaient mises en place pour protéger le droit de manifester ?
Il ne faut donc pas s’arrêter aux grands discours mais regarder ce qu’il se passe ensuite. Ainsi Bruno Lemaire a-t-il commencé à lâcher le morceau : il faudra se serrer la ceinture. Les premières mesures d’urgence temporaires (cela commence toujours comme ça) ont consisté à attaquer le droit du travail. Geoffroy Roux de Bézieux, suivi par le fameux Institut Montaigne, nous annoncent la couleur pour la suite : il faudra remettre en questions les congés payés et les jours fériés. En Suisse, un syndicat patronal demande aux autorités de planifier au plus vite le retour à la normale, et nous alerte : “Il faut éviter que certaines personnes soient tentées de s’habituer à la situation actuelle, voire de se laisser séduire par ses apparences insidieuses : beaucoup moins de circulation sur les routes, un ciel déserté par le trafic aérien, moins de bruit et d’agitation, le retour à une vie simple et à un commerce local, la fin de la société de consommation…”. Le message est clair, reprenons vite comme avant, il ne faudrait pas que les gens se mettent à réfléchir et remettent en question notre mode de vie !
Côté environnemental, l’affaire est conclue, aucune contrepartie ne sera demandée aux entreprises qui bénéficient des 20 Md€ d’aide de l’Etat Français.
Nous avons compris, si l’on veut que le jour d’après ressemble un tant soit peu à nos souhaits, un sacré rapport de force devra s’engager contre nos dirigeants actuels. Heureusement pour le gouvernement, contrairement aux masques et aux tests, les stocks de gaz lacrymogènes et LBD sont toujours parfaitement approvisionnés.
La social-démocratie
Mais prenons-nous à rêver que le rapport de force nous soit tellement favorable que le gouvernement se retire et laisse place à une force de gauche voulant s’engager dans la direction présentée. Bizarrement, on sent que même sous ces conditions, ça ne serait pas gagné. Notre programme serait-il utopique ? Ou peut-être est-ce l’expérience de 40 ans de social-démocratie qui nous a vaccinés… Il est vrai qu’on a vu défiler les promesses jamais tenues depuis des années, au point que nous nous sommes plus à qualifier toute une classe politique de sociaux-traîtres. C’est pratique, ça défoule. Mais c’est un peu court car des raisons plus profondes expliquent leur capitulation systématique. Pour les comprendre, il faut s’attaquer à deux non-dits : la fondamentale incompatibilité du programme avec les structures capitalistes et les forces de rappel du système empêchant tout changement de cap.
Le capitalisme. Voilà, nous avons lâché le mot trop souvent évité. Il nous faut pourtant en passer par lui. Qu’on ne se méprenne pas, ce n’est pas une question de mot fétiche qu’il faudrait absolument utiliser pour afficher son appartenance au bon camp. Si ce mot a son importance c’est parce qu’il nous permet d’avoir une analyse radicale des problèmes, au sens où il remonte à leur racine.
Quelles dynamiques à l’oeuvre dans le capitalisme ?
Pour comprendre l’importance du concept, revenons à la base. Le mode de production capitaliste repose sur la propriété lucrative des moyens de production comme moteur de l’économie, c’est à dire sur la possibilité pour le détenteur du capital de tirer des revenus de son patrimoine investi en moyens de production. Ainsi la valeur ajoutée, la valeur créée par le travail, est ensuite partagée entre les travailleurs, rémunérés pour leur travail (sous forme de salaires par exemple), et le propriétaire de l’outil de travail qui tire le profit de son investissement (sous forme de dividendes par exemple).
Cette simple définition fait immédiatement apparaître deux dynamiques élémentaires.
Tout d’abord l’accumulation du capital. En effet, le capital permettant l’extraction d’un profit sur le travail des autres va s’accumuler soit chez des individus (nos milliardaires dont Forbes se plaît à tracer l’héroïque trajectoire tous les ans) soit dans des structures (fonds de pension par exemple). La dynamique inégalitaire sera ensuite contrebalancée par une redistribution des ressources, dont l’impôt est un des moyens. L’Etat social a été créé progressivement pour adoucir les effets de la dynamique capitaliste.
Le deuxième élément lié à ce mode de production est le pouvoir des détenteurs du capital sur le travail, et plus généralement sur toute la société. Au-delà d’un mode d’organisation de la production, le capitalisme est aussi un rapport de domination. Il donne un pouvoir démesuré à la classe possédante puisque celle-ci décide par ses investissements et son pouvoir sur les entreprises de ce qui est produit, de qui sera rémunéré pour le faire et dans quelles conditions. Le reste de la population est soumis au marché du travail et charge à chacun de trouver à s’embaucher chez un capitaliste qui voudra bien le rémunérer pour son travail. Et encore, quand il n’est pas directement soumis aux aléas du marché des biens et services sur lequel il cherchera à vendre le fruit de son travail, comme c’est de plus en plus le cas avec l’ubérisation qui n’est qu’un retour au statut des travailleurs du XIXème siècle, avant les conquêtes du code du travail. L’actuelle situation précaire des travailleurs indépendants pendant le confinement nous rappelle à quel point le salariat a malgré tout été un progrès.
A la source de toute décision d’investissement, seule compte donc la possibilité d’extraire un profit de la production. Le capitalisme est indifférent à la valeur d’usage de ce qui est produit. Un bien très utile pourra ne pas être produit si l’on ne peut pas en tirer de profit (il suffit de penser aux médicaments qui manquent dans les pays pauvres). Inversement, la publicité et la société de consommation créent tout un tas de besoins et de marchandises d’aucune utilité si ce n’est celle de rémunérer du capital. Longtemps, être un bon citoyen a d’ailleurs été associé à être un bon consommateur, rouage indispensable à la machine. On comprend aussi que l’obsolescence programmée (qui a une utilité négative pour le consommateur et la planète) est bénéfique pour le capital puisqu’elle augmente la consommation de marchandises. De la même manière, la mise en concurrence généralisée offerte par la mondialisation permet de profiter d’une main d’oeuvre bon marché, de s’affranchir des réglementations écologiques ou fiscales, et offre ainsi un terrain de jeu optimal pour accroître les profits.
La course au profit, l’indifférence à ce qui est produit, le consumérisme comme moteur, tout ça commence à nous faire comprendre le rôle essentiel du capitalisme dans la catastrophe écologique. De plus, la dynamique de ce système basé sur les initiatives privées en recherche d’une maximisation de leurs profits, est par nature incapable d’intégrer les frontières écologiques de la planète, aussi appelées externalités. Le souhait de réguler le capitalisme pour obliger les acteurs à intégrer ces contraintes est une course sans fin, impossible à mettre en oeuvre dans la pratique, et un regard historique nous enseigne d’ailleurs sur les échecs constants de ces tentatives1.
Les bases étant posées, on constate que beaucoup de nos problèmes sociaux et environnementaux ne découlent pas seulement de mauvais comportements humains individuels qu’il faudrait corriger, ils découlent d’abord de manière automatique des structures capitalistes, c’est à dire de l’organisation de notre mode de production2.
Notons au passage qu’il faut bannir tout discours moral au sujet du capitalisme, de l’action des entreprises, de leurs dirigeants ou actionnaires. Quiconque a déjà mis les pieds dans une entreprise sait de quoi il retourne. Un dirigeant peut-il décider de ne pas délocaliser sa production quand tous ses concurrents le font ? Son produit serait alors plus cher et il perdrait ses clients, que ces derniers soient d’autres entreprises, des particuliers, ou même l’Etat. Prendre des décisions à l’encontre de la compétitivité de son offre menacerait ainsi la survie de son entreprise et l’emploi de ses salariés. Un dirigeant peut-il agir contre les actionnaires qui le nomment et attendent le meilleur retour sur investissement possible ? Il sera renvoyé3. Et les actionnaires, peuvent-ils être moraux eux au moins ? Pensons à l’employé de Blackrock qui gère les retraites des citoyens américains. Peut-on lui reprocher d’essayer de faire son travail du mieux possible en optimisant les profits qui assurent les pensions des retraités ? Il est vain de chercher à condamner des comportements immoraux, même s’ils existent, car tout est mécanique. Il y aurait bien des responsabilités à rechercher du côté de ceux qui ont contribué à mettre en place et renforcé les structures du capitalisme. Mais il est ensuite difficile d’incriminer les acteurs d’un système agencé pour produire des comportements conformes à ses règles et pénaliser ceux qui ne se s’y soumettent pas.
Croissance et capitalisme
Dans son dernier ouvrage4, Benoît Borrits rappelle qu’une croissance forte de la valeur ajoutée (c’est à dire du PIB – Produit Intérieur Brut) est un critère important pour le bon fonctionnement du capitalisme. En effet, à répartition inchangée de la valeur ajoutée entre le profit et le travail, il permet d’assurer une croissance naturelle des dividendes qui suivra la croissance de l’économie. Cette croissance des profits garantit la valorisation du capital investi et donc la bonne dynamique du système. Car sans perspective de gains, pas d’investissement, et donc pas de production ni de consommation, et tout le système se grippe. Par conséquent, tous les scénarios de décroissance du PIB ne remettant pas en cause le mode de production capitaliste nous semblent manquer cruellement de réalisme.
Lire la suite sur les Infiltrés